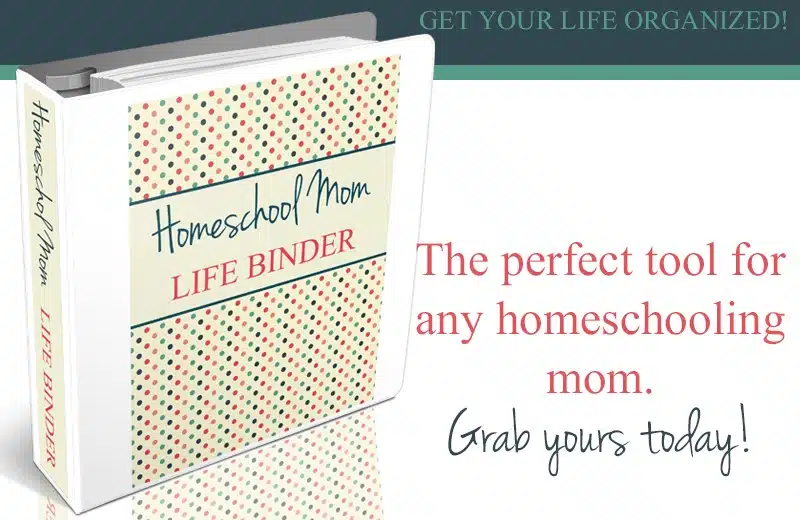12% des hommes se disent passionnés de mode, contre 8% des femmes. Ce chiffre surprend, il dérange les clichés et bouscule nos certitudes. Derrière les apparences lisses, la réalité s’avère bien plus nuancée qu’on ne le croit.
Les chiffres de l’IFOP, publiés en 2023, révèlent une singularité : plus d’hommes que de femmes affirment acheter des vêtements d’abord pour leur plaisir. Pourtant, d’autres enquêtes le confirment : ce sont les femmes qui, chaque année, consacrent davantage de temps et une part plus large de leur budget à la chasse aux nouvelles tendances. Voilà un paradoxe qui traverse les frontières et s’installe dans la plupart des sociétés occidentales. Les comportements d’achat, l’engagement avec les marques, la place accordée à la mode : tout cela dessine un paysage bien plus contrasté qu’il n’y paraît.
La mode, reflet de nos identités et révélateur de nos désirs
Réduire la mode à une simple affaire d’apparence serait une erreur. Elle fonctionne comme un langage social : chaque vêtement, chaque détail, affiche une appartenance, une trajectoire, parfois une ambition. En France, porter un sweat à capuche ou une chemise bien coupée ne relève pas du hasard. On ne choisit pas innocemment entre une pièce de créateur et un basique acheté chez H&M. Le vêtement, Bourdieu l’a montré, dit d’où l’on vient et où l’on veut aller : histoires familiales, milieux d’origine, parcours personnel, rien n’échappe à ce jeu de signes.
À Paris, la scène est partout. Dans les couloirs du métro ou sur les terrasses animées, la silhouette se transforme en manifeste. Parfois, elle affirme un statut ; parfois, elle le défie. Les normes imposent des cadres, mais chacun les réinterprète à sa façon. La mode distribue les rôles, mais elle laisse aussi la place au détournement, à la subversion, à l’imitation. Elle sépare, mais elle rassemble, par effet de groupe ou par geste de rupture.
Dans certains milieux, la tenue soignée est un passeport : signe de respectabilité, voire de réussite sociale. Ailleurs, afficher une décontraction assumée devient une manière de se distinguer, d’afficher d’autres valeurs. Le vêtement balise la frontière entre groupes sociaux, révèle le rapport à soi et aux autres, tout en composant avec le regard des pairs ou de la société. Il suffit de traverser quelques rues ou de comparer deux générations pour constater : un même vêtement raconte toujours une histoire différente.
La mode, affaire de genre ou de société ?
Le vêtement, dans l’esprit collectif, serait une préoccupation avant tout féminine. Les stéréotypes ont la vie dure : la mode relèverait du souci des femmes, tandis que les hommes resteraient dans l’ombre, indifférents, attachés au côté pratique. Mais les sciences sociales nous invitent à regarder au-delà de ces clichés.
Voici quelques repères issus des recherches récentes :
- Les travaux d’Isabelle Clair, Martine Court et Gérard Mauger montrent que la distinction ne s’arrête jamais à une simple opposition entre hommes et femmes.
- Plus que le sexe, la classe sociale façonne la relation à la mode et l’attention portée au vêtement.
Chez les jeunes hommes des classes populaires, l’apparence devient un enjeu fort : il s’agit d’affirmer sa place, de répondre aux attentes du groupe, de marquer sa masculinité. À l’inverse, certains milieux plus aisés préfèrent la discrétion, la sobriété, parfois le refus de toute ostentation. Quant à la féminité, elle se décline elle aussi selon le contexte social et la perception collective. Loin d’un simple clivage hommes/femmes, la mode s’organise autour de stratégies d’appartenance, de résistance ou de conformité, toujours en dialogue avec les normes du groupe.
Certaines études, comme celles de Claude Fosse et Aurélia Mardon, soulignent : chez les jeunes, l’intérêt pour la mode oscille entre désir de se démarquer et besoin de se fondre dans la masse. Origines, milieux, codes partagés : autant de paramètres qui pèsent plus lourd que le sexe dans les usages vestimentaires.
Identités de genre, orientations sexuelles : la mode comme espace d’expression
La mode, ce n’est pas seulement une question de genre assigné à la naissance. Chaque coupe, chaque motif, chaque accessoire vient dire quelque chose de plus : identité de genre, orientation sexuelle, trajectoire de vie. Les frontières sont poreuses, mouvantes, et les styles éclatent en mille possibilités.
Des chercheurs comme Lucie Bargel, Muriel Darmon et Christine Bard éclairent la diversité des parcours. Les personnes trans, non-binaires, homosexuelles ou bisexuelles inventent des codes propres, détournent les attentes, font du vêtement un emblème ou un rempart. Affirmer qui l’on est, revendiquer sa place, échapper aux contraintes : la mode devient un terrain d’expression et parfois de résistance.
Pour mieux saisir la variété des situations, voici deux notions importantes :
- L’orientation sexuelle : elle concerne l’attirance amoureuse ou sexuelle, qu’elle vise le même genre, un autre, plusieurs ou aucun.
- L’identité de genre : c’est la manière dont chacun se situe, se reconnaît (ou non) dans le masculin, le féminin, ou ailleurs sur le spectre.
Si les normes sociales conservent leur force, la mode s’impose comme un espace de visibilité, de revendication, parfois de prudence selon les contextes. L’audace, la discrétion, les stratégies de reconnaissance varient selon le regard porté, la position sociale et l’environnement. Les pratiques vestimentaires témoignent ainsi d’une société mouvante, traversée de tensions, d’élans nouveaux et de liens inattendus.
La richesse de la mode : respecter et accueillir la diversité
La mode s’enrichit de ce qui la distingue : différences de parcours, de milieux, de trajectoires de vie. Les choix vestimentaires disent parfois la volonté de s’affirmer, parfois celle de résister à la pression ou à la stigmatisation. Les premières lignes se dessinent souvent dès l’enfance, à l’école ou en famille, et s’exacerbent sur les réseaux sociaux. Dans certains groupes, l’exigence de conformité peut se transformer en barrière, notamment pour celles et ceux qui revendiquent une identité de genre ou une orientation sexuelle minoritaire.
Dans ce contexte, le vêtement devient un outil : il protège, il affirme, il interroge l’ordre établi. Les personnes issues des milieux populaires affrontent des normes plus dures, dictées par la nécessité de se fondre dans le groupe. L’histoire du pantalon, telle qu’elle est racontée dans les ouvrages publiés aux Puf, le prouve : chaque évolution vestimentaire accompagne un déplacement des frontières sociales et culturelles.
Plusieurs réalités s’imposent aujourd’hui :
- La biphobie et l’exclusion créent encore des obstacles sur de nombreux parcours.
- Les réseaux sociaux, s’ils ouvrent des espaces d’affirmation, servent aussi parfois de caisse de résonance au rejet et à la stigmatisation.
Miroir de nos sociétés, la mode porte la mémoire des combats et des avancées. Elle donne à voir la capacité d’inventer de nouvelles formes de vivre-ensemble, où respecter et accueillir la différence devient la matière première de la création. En filigrane, ce sont les contours d’une société plus ouverte, plus vivante, qui se dessinent, vêtement après vêtement.